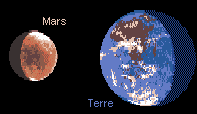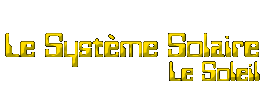
Mars
Quatrième planète en partant du Soleil, Mars, mesure 6 794 km de diamètre et est presque deux fois plus petite que la Terre. Comme la Terre, elle tourne sur elle-même en un jour (24 h 40 mn
exactement). Comme la Terre, son axe de rotation est incliné de 24°, ce qui
induit, comme sur notre planète, quatre saisons bien définies. Comme la Terre,
encore, Mars possède deux pôles recouverts par les glaces, qui régressent en été
et se renforcent en hiver. Mais Mars, avant tout, c'est la planète désert : sa
surface, égale à celle de tous les continents terrestres, n'est qu'une immense
étendue de sables et de roches. L'air martien est de cent à mille fois plus
raréfié que celui de la Terre, et composé presque exclusivement de dioxyde de
carbone. autrement dit, Mars est "irrespirable". Les conditions atmosphériques
sont aujourd'hui la seule chose qui change, sur Mars. Des tempêtes voire des
cyclones ressemblant à s'y méprendre aux ouragans terrestres sont fréquents sur
la planète rouge. L'intense activité de l'atmosphère martienne est justement due
à la faible densité de l'air. En plein été, au cours d'une seule journée, entre
l'aube et le milieu de l'après-midi, la température peut passer de -100 °C à 0
°C ! Ce sont de tels écarts de température qui perturbent l'équilibre de
l'atmosphère et qui peuvent provoquer de véritables cyclones. Chaque année, au
début de l'été martien, l'échauffement entraîné par la proximité du Soleil
bouleverse l'atmosphère martienne, et de forts vents se lèvent un peu partout
sur la planète rouge. Vers le solstice d'été, les vents de plus en plus violents
soulèvent les plus fines des particules qui recouvrent uniformément le sol. En
quelques semaines, cette grande tempête de poussière envahit la planète entière
et la couvre d'un véritable brouillard de sable, si dense que, depuis son
orbite, la surface de Mars est invisible. Dans un silence presque absolu, le vent souffle par rafales à 150, 180, voire 200 km/h. Pourtant, rien ne bouge. Les dunes restent figées, le sable ne s'envole pas. Sur Mars, l'atmosphère est si ténue que le vent ne peut agir sur les choses. Seules des particules microscopiques et invisibles sont emportées. La caméra de la sonde Viking 2 a pourtant permis de saisir la portée d'un tel événement : le Soleil, masqué par un brouillard dense, ne projetait plus d'ombres sur le paysage, et l'horizon était légèrement voilé. C'était cela, la grande tempête martienne...A la longue, les tempêtes ont érodé la surface, émoussant les cratères d'impacts, soulevant les poussières dans les hautes plaines, les déposant au fond des vallées sinueuses, sculptant par endroits des champs de dunes, déblayant lentement certains plateaux. A la longue, les paysages s'en sont trouvés modifiés. Les grands regs de Chryse et d'Utopia, où se sont posées les deux sondes Viking (sites "d'amarsissage"), montrent partout les traces de cette érosion éolienne, des bancs de sable jusqu'aux rochers façonnés en petites pyramides, par les vents silencieux qui soufflent en tempête depuis la nuit des temps...Mais le processus est très long. Viking 2, durant les sept années qu'ont duré sa mission, n'a rien vu changer sur Mars. Les quatre saisons, à la latitude élevée (47° N.) où se trouvait la sonde, lui ont permis d'enregistrer une "chute de neige" un matin d'hiver, lorsque la température avoisinait -130 °C. Les grandes tempêtes de poussière voilèrent et assombrirent le ciel. C'est tout. Quant à Viking 1, qui filma le paysage sans discontinuer durant quatre ans, il remarqua juste, au pied d'un gros rocher, un infime glissement de quelques centimètres
cubes de sable...
Petit matin sur Olympus Mons (cf photo ci-dessous). Une morne plaine de basaltes
gris, d'anciennes coulées de laves, saupoudrées de sable orange, éclairées
durement par un soleil qui, à peine surgi à l'horizon, semble étrangement
brillant. Le froid est terrible, -140 °C. Le ciel, orangé à l'horizon, vire
anormalement vite au bleu nuit. Notre plaine caillouteuse est légèrement
inclinée vers le nord, selon une pente de 5°, mais n'offre pas de relief
particulier. Au sud, le regard se perd à une distance vertigineuse. Au nord,
rien que la lave figée depuis quelques milliers de millénaires. Au-dessus, un
ciel indigo où luisent quelques étoiles. Venant de l'ouest comme à
contre-courant du cycle des étoiles, Phobos s'apprête à traverser
majestueusement le ciel. Brillant comme Vénus depuis la Terre, sa forme oblongue
parfaitement reconnaissable à l'il nu (vu depuis la surface martienne, Phobos
mesure presque 15 minutes d'arc, soit à peu près la moitié de la Lune), il ira
se coucher vers l'est quelques quatre heures plus tard.
Un banal paysage martien ? Le froid intense, le ciel d'une limpidité
cristalline, où brillent - en plein jour - les étoiles, laissent pourtant un
parfum d'étrangeté. Cette vague pente douce est en fait le flanc d'un volcan
monstrueux, littéralement la plus grande montagne de l'Univers connu. Olympus
Mons mesure 27 000 m d'altitude et environ 1 000 km de diamètre à la base ! Au
bord de la caldeira sommitale, côté cratère, un spectacle stupéfiant : les
remparts presque verticaux, hauts de 3 000 m, qui l'encerclent se perdent dans
les lointains, en un immense arc de parabole, et ne se rejoignent que 80 km plus
loin, derrière l'horizon !
II n'existe aucun édifice géologique aussi gigantesque qu'Olympus Mons, ailleurs
dans le Système solaire. Olympus Mons, comme les trois autres volcans géants qui
l'accompagnent, Pavonis Mons, Arsia Mons et Ascraeus Mons, doit son existence à
la faible pesanteur martienne et surtout à l'absence de mouvements d'ensemble de
la croûte : la lave, venue des profondeurs dans un très lointain passé, a percé
la croûte en un "point chaud", comme disent les planétologues, puis, durant des
dizaines ou des centaines de millions, peut-être même des milliards d'années,
s'est épanchée à la surface, agrandissant lentement l'édifice volcanique.
Les grands volcans martiens sont tous situés non loin de l'équateur de la
planète, dans la région de la dorsale de Tharsis. II s'agit d'un immense dôme de
6 000 km de diamètre, qui a soulevé la croûte martienne d'environ 7 000 m.
Tharsis est traversée par une gigantesque brèche de près de 5 000 km de long, le
réseau de canyons de Valles Marineris.Ophir Point dans Valles Marineris Paysage
pour géants : lorsque le soleil se lève à une extrémité, vers Coprates Chasma, à
l'ouest, Tithonium Chasma est toujours plongé dans la nuit la plus noire.
L'origine de Valles Marineris reste incomprise des planétologues ; très longue,
large de 250 km, elle exhibe de part et d'autre du fossé qu'elle dessine des
falaises hautes de 3 000 à 7 000 m de hauteur !
L'ampleur et la majesté de ce monument naturel n'ont d'équivalent ni sur Terre
ni sur aucune autre planète connue. Ouvert récemment, il y a peut-être seulement
1 ou 2 milliards d'années, le fossé de Valles Marineris a continué régulièrement
à s'agrandir depuis lors. Patiente érosion par le vent qui souffle constamment
dans les canyons, respirations régulières de la planète entraînant de temps en
temps des avalanches : insensiblement, les remparts de Valles Marineris
reculent.
Le survol de Valles Marineris révèle un spectacle fantastique : tout le long des
flancs du grand canyon martien, des glissements de terrain ont entraîné des pans
entiers du rempart, laissant derrière eux d'immenses cirques d'arrachement (cf
photo ci-dessus). Dans Coprates Chasma, la plus monstrueuse de ces avalanches a
fait s'écrouler d'un coup un pan de montagne de 60 km de long... Difficile
d'imaginer cette scène d'apocalypse, sans témoins : dans un grondement sourd,
des milliers de milliards de tonnes de terre martienne dévalant le flanc du
canyon à 200 km/h, avant de s'arrêter une demi-heure plus tard 7 000 m plus bas
et 100 km plus loin !

.jpg)
Meade 254mm Barlow x 2 Vesta PRO Meade 254mm Vesta PRO
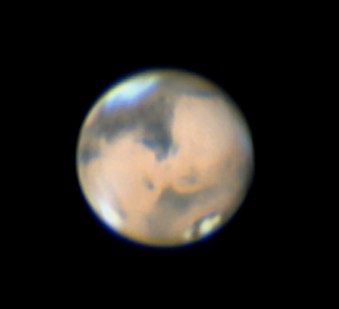
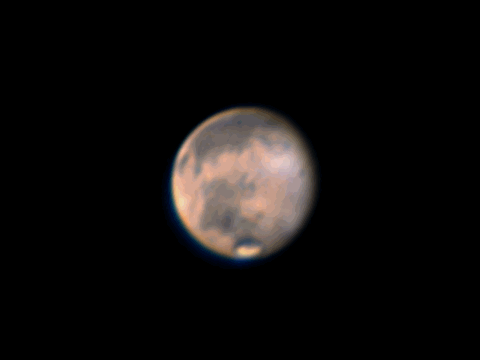
dobson motorisé, flextube 305 mm focale 1500mm

Mars 2018-05-06 Newton 200-1000 barlow x3 ASI 224

TAILLE