Le Soleil est le centre du système solaire et une étoile parmi
tant d'autres dans notre galaxie (la Voie Lactée).
Notre étoile n'est pourtant pas banale. En effet, comparé à l'ensemble des
astres de la Voie Lactée, le Soleil est une étoile plutôt massive et plutôt
brillante. La plupart des étoiles sont dix fois massives, dix fois plus petites,
dix, cent, mille ou un million de fois moins brillantes que lui. Quelques
milliards d'entre elles, seulement, sont plus massives et plus lumineuses.
Le Soleil n'est qu'à 150 millions de kilomètres de la Terre. Sa lumière met huit
minutes à nous parvenir alors que la lumière de Sirius, étoile la plus brillante
de notre ciel après lui, met huit ans !
Le Soleil est né voici 4,55 milliards d'années, de l'effondrement gravitationnel
d'un nuage d'hydrogène et d'hélium.
Le Soleil est une énorme sphère gazeuse de 1,4 million de kilomètres de
diamètre. Sa surface, en apparence très nette, s'appelle la photosphère : c'est
la première couche gazeuse transparente, qui laisse passer le rayonnement né au
coeur de l'étoile.
Au-dessus de la photosphère s'élèvent deux autres milieux gazeux, transparents
et raréfiés, la chromosphère et la couronne. Ces "atmosphères" solaires sont
difficiles à observer, car elles sont généralement noyées dans l'insupportable
lumière de l'étoile. Sur Mercure ou sur la Lune où il n'existe pas d'atmosphère
pour diffuser sa lumière, chromosphère et couronne apparaissent lorsque le
disque du Soleil disparaît derrière un lointain rocher.
Sur la Terre, où le ciel bleu est trop brillant, admirer la couronne solaire
relève de l'exploit puisqu'il faut profiter d'un événement rarissime : une
éclipse totale de Soleil !
La masse du Soleil - 2 milliards de milliards de milliards de tonnes (2.10^27 T)
- est près de mille fois supérieure à celle de toutes les planètes du Système
solaire. La densité moyenne du Soleil est à peine supérieure à celle de l'eau :
1,4. Sa composition est celle des étoiles : environ 70% d'hydrogène, 28%
d'hélium et 2% d'atomes lourds, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le néon,
le fer...
Le Soleil ne continuera pas éternellement à dispenser sa lumière et sa chaleur
aux planètes du Système solaire.
Depuis 4,55 milliards d'années, le Soleil s'est appauvri en hydrogène et enrichi
en hélium. Actuellement, dans le noyau solaire, la fusion thermonucléaire se
poursuit au même rythme, un rythme que notre étoile peut tenir encore quelque 4
ou 5... milliards d'années.
Arrivé au terme de cette période, le Soleil aura presque intégralement
transformé son hydrogène central en hélium, et sa production d'énergie nucléaire
ralentira. La pression fantastique créée jusqu'ici par la fusion thermonucléaire
baissera, et le noyau d'hélium, soumis dès lors à la seule force de gravitation,
commencera à s'effondrer lentement sur lui-même.
La contraction du noyau s'accompagnera d'une dilatation des différentes
atmosphères solaires. Le Soleil se transformera en un astre gigantesque,
dépassant 100 millions de kilomètres de diamètres, et visible de toute la
Galaxie : une géante rouge, mille fois plus lumineuse que notre étoile
aujourd'hui. Dès lors débutera un processus irréversible qui marquera la fin de
l'aventure solaire.
L'étoile géante enflera jusqu'à engloutir ses plus proches planètes, Mercure et
Vénus. Sur la Terre, la tempête solaire vaporisera en quelques instants
l'atmosphère et les océans, carbonisant montagnes et continents. Tous les
matins, pendant près de 1 milliard d'années, un globe rouge sang auréolé de
flammes se lèvera sur un désert de cendres.
.Puis, subissant des contraintes internes de plus en plus fortes, le Soleil,
instable, commencera à battre lentement, comme un coeur fatigué. A chacune de
ses amples respirations, ses protubérances viendront lécher la surface de notre
planète morte.
Enfin, brutalement, le Soleil explosera, expirant dans l'espace une grande
partie de sa masse, annihilant au passage son cortège planétaire, soufflant aux
quatre vents de la Galaxie la matière nouvelle qu'il aura créée durant 10
milliards d'années, promesse de futures générations d'étoiles...
.gif)
.gif)
Lunt 80 DSII Basler 1300

Lunt 80 DMK 21 barlow x3
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Lunt 100 Caméra Basler 1300
taches solaires
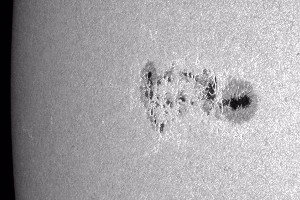
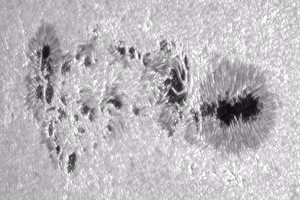 .
.
Télescope Dobson Orion N 203/1200

Pour espérer voir une éclipse totale en France, il faudra en revanche attendre le 3 septembre 2081. Vous voilà prévenus.
| Date | Maximum | Type | Durée max | Parcours |
| 26 février 2017 | Annulaire | Annulaire | 0 min 44 s | Afrique du Sud, Amérique du Sud |
| 21 août 2017 | Totale | Totale | 2 min 40 s | Amérique du Nord |
| 15 février 2018 | Partielle | Partielle | Antarctique, Amérique du Sud | |
| 13 juillet 2018 | Partielle | Partielle | Australie | |
| 11 août 2018 | Partielle | Partielle | Europe, Asie | |
| 6 janvier 2019 | Partielle | Partielle | Asie | |
| 2 juillet 2019 | Totale | Totale | 4 min 33 s | Amérique du Sud |
| 26 décembre 2019 | Annulaire | Annulaire | 3 min 39 s | Asie |
| 21 juin 2020 | Annulaire | Annulaire | 0 min 38 s | Asie |
| 14 décembre 2020 | Totale | Totale | 2 min 10 s | Amérique du Sud |
| 10 juin 2021 | Annulaire | Annulaire | 3 min 51 s | Amérique du Nord, Europe |
| 4 décembre 2021 | Totale | Totale | 1 min 54 s | Antarctique |
| 30 avril 2022 | Partielle | Partielle | Amérique du Sud |
48 photos du soleil. Prises pendant un an, une fois par semaine, au même endroit et à la même heure. Le point le plus haut est le solstice d'été et le point le plus bas est le solstice d'hiver
